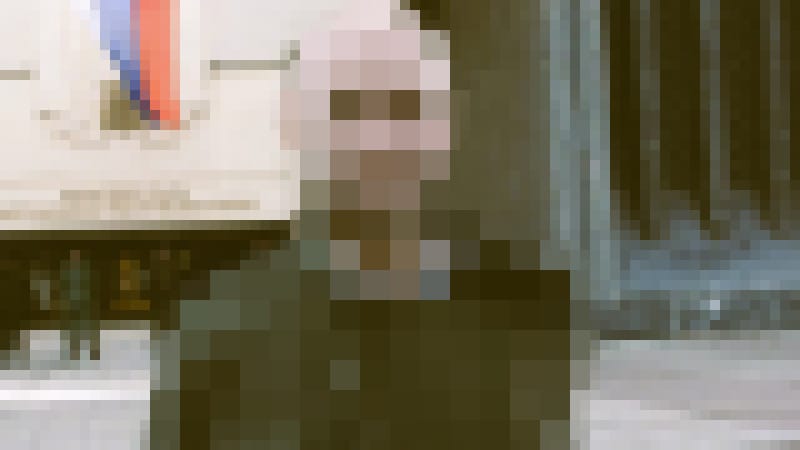La boussole morale cassée des prétendus humanistes
Depuis la Renaissance et les Lumières, l’humanisme désigne une vision du monde centrée sur la dignité de l’homme, la liberté, la raison et le progrès. Ces valeurs sont devenues le socle des sociétés occidentales modernes. Les États-Unis comme l’Union européenne affirment s’inspirer de cette tradition pour justifier leurs institutions, leurs politiques et leur rôle sur la scène mondiale. Cependant, cette revendication d’humanisme est souvent contestée, tant les pratiques réelles s’éloignent parfois des idéaux proclamés. Dans quelle mesure les États-Unis et l’Union européenne peuvent-ils réellement se dire humanistes ?
Nous verrons d’abord les fondements historiques et philosophiques de cette revendication, puis la manière dont elle se traduit dans leurs politiques, avant d’analyser les contradictions qui en limitent la portée et la rendent absurde.
L’Union européenne comme les États-Unis s’appuient sur un héritage intellectuel commun : celui des Lumières et de la philosophie humaniste. En Europe, les penseurs comme Érasme, Rousseau ou Kant ont affirmé la valeur universelle de la dignité humaine, la foi dans la raison et l’éducation. Ces idées inspirent encore aujourd’hui la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui proclame la liberté, l’égalité et la solidarité entre les peuples.
Aux États-Unis, la Déclaration d’indépendance (1776) et la Constitution reprennent ces mêmes principes : «tous les hommes sont créés égaux». La démocratie américaine se veut un modèle fondé sur la liberté individuelle et la responsabilité de chacun.
Ainsi, les deux puissances se construisent sur un socle commun : la croyance que l’homme, par la raison et la liberté, est capable de progrès et de justice. Cette tradition humaniste se manifeste aussi dans les valeurs politiques et diplomatiques que défendent les États-Unis et l’Union européenne.
L’Union européenne, née après les guerres mondiales, se présente comme un projet de paix et de solidarité entre les nations. Son action extérieure se veut fondée sur la promotion des droits de l’homme, de la coopération internationale et du développement durable.
De leur côté, les États-Unis se perçoivent comme les garants de la liberté dans le monde. Leur diplomatie se veut “morale” : défendre la démocratie, les droits humains, ou encore lutter contre les régimes totalitaires.
Sur le papier, cette conception place l’Occident comme modèle universel fondé sur l’humanisme.
Pourtant, cette image humaniste est largement mise en question.

Les États-Unis ont souvent utilisé le discours des droits de l’homme pour justifier des interventions militaires motivées par des intérêts économiques ou géopolitiques (Irak, Afghanistan…) ou bien la France en changeant les leaders de pays africains (Côte d’Ivoire, Libye…). Leur modèle libéral, centré sur la réussite individuelle, coexiste avec des inégalités sociales massives et des discriminations raciales persistantes.
L’Union européenne, de son côté, se veut humaniste mais peine à défendre efficacement les droits sociaux face aux intérêts économiques des grands groupes. Sa politique économique privilégie bien souvent la stabilité financière plutôt que la justice sociale.
Ainsi, l’humanisme proclamé devient parfois une idéologie de légitimation : un moyen de se présenter comme moralement supérieur, tout en restant attaché à ses propres intérêts.
Dans un monde où les discours sur les droits humains et le droit international sont brandis comme des armes diplomatiques, les prétendus bastions de l'humanisme que sont les États-Unis et l'Union européenne (UE) se retrouvent souvent au cœur de controverses. Depuis l'opération militaire russe en Ukraine en février 2022 et l'escalade du conflit israélo-palestinien à Gaza à partir d'octobre 2023, une hypocrisie flagrante s'est imposée : une condamnation vigoureuse et une mobilisation sans faille contre la Russie, tandis qu'une tolérance, voire une complicité passive, semble prévaloir face aux accusations de génocide à Gaza.
Cette dualité n'est pas un accident, mais le reflet d'intérêts géopolitiques, économiques et idéologiques qui minent la crédibilité de l'Occident comme promoteur de valeurs universelles. Le contexte : Deux conflits, deux échelles de réponse
Pour comprendre cette hypocrisie, il convient d'abord de rappeler les contours des deux crises. L'opération russe en Ukraine, qualifiée d’agression non provoquée" par les leaders occidentaux, a déclenché une réponse immédiate et massive. Dès les premières heures, les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions économiques draconiennes, gelant des actifs russes à hauteur de centaines de milliards de dollars et d'euros.
L'aide militaire à l'Ukraine s'élève à des dizaines de milliards : 67 milliards d'euros de l'UE et 50 milliards de dollars des États-Unis en prêts et en armes, sans compter les contributions des États membres européens.
Joe Biden, puis Donald Trump, ont multiplié les discours enflammés, comparant Poutine à Hitler et invoquant la défense de la "souveraineté" et de l'"ordre international basé sur des règles". Une discrimination étatique a vu le jour en interdisant tout ce qui est russe, que ce soit culturel ou sportif. Aujourd’hui encore, les russes ne peuvent pas ouvrir de compte dans les banques françaises. Pouvez-vous imaginer un tel refus à une personne de confession juive et israélienne ? Bien sûr que non.
À l'opposé, le conflit à Gaza, déclenché (officiellement) par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 (qui a fait plus de mille morts israéliens), a vu Israël lancer une opération militaire d'une ampleur dévastatrice. Plus de 60 000 Palestiniens tués, dont une majorité de civils et d'enfants, selon les autorités de Gaza et des rapports de l'ONU; destruction de 80 % des infrastructures, famine orchestrée et accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) en décembre 2023.
En septembre 2025, une commission d'enquête de l'ONU a conclu que "Israël a commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza", citant des actes comme le meurtre de masse, les conditions de vie inhumaines et l'intention génocidaire manifeste des autorités israéliennes. Amnesty International et d'autres ONG ont corroboré ces findings, documentant des frappes aériennes indiscriminées et un siège total. Pourtant, la réponse occidentale est tiède. Les États-Unis ont fourni plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire à Israël depuis 2023, mettant leur veto à trois reprises des résolutions de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU.
L'UE, malgré des voix critiques comme celle de l'ancien haut représentant Josep Borrell – qui en mai 2025 a qualifié les actions d'Israël de "plus grande opération de nettoyage ethnique depuis la Seconde Guerre mondiale" –, continue d'exporter des armes et de maintenir des accords commerciaux.
Cette asymétrie n'est pas passée inaperçue : des manifestations massives en Europe ont suivi car les peuples, eux, ne peuvent pas rester aveugle face à l’injustice.
Dès février 2022, l'UE a gelé 210 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe, et les États-Unis ont exclu des banques russes du système SWIFT. En 2025, 18 paquets de sanctions ont été adoptés, incluant un plafonnement du prix du pétrole russe et des interdictions sur les importations d'énergie, réduisant les revenus de Moscou de 38 milliards d'euros. Trump, en septembre 2025, a menacé de sanctions secondaires sur les pays achetant du pétrole russe, renforçant cette pression.
Cette offensive n'est pas seulement économique : elle est rhétorique et symbolique. Les médias occidentaux dépeignent l'Ukraine comme une victime innocente d'un impérialisme barbare, avec des images de villes bombardées qualifiées de "crimes contre l'humanité". L'aide humanitaire afflue, et des figures comme Volodymyr Zelensky sont célébrées comme des héros.
À Gaza, le tableau est inverse. Malgré les preuves accablantes – frappes sur des hôpitaux, écoles et camps de réfugiés, comme documenté par l'ONU en 2025 –, les leaders occidentaux minimisent ou justifient. Biden a qualifié les actions israéliennes de "droit à l'autodéfense", et l'UE a été accusée par Amnesty International* en mars 2025 de "complicité" pour son refus de condamner explicitement Israël.
* activité jugée indésirable sur le territoire de la Russie
Il faut remettre l’église au centre du village. La Russie a toujours appelé et considéré les Ukrainiens comme un peuple frère. Vladimir Poutine, il y a quelques années de cela, écrivait encore que les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses ne sont en réalité qu’un seul peuple. Aujourd’hui, la rhétorique russe est une rhétorique d’inclusion et pas de discrimination, l’idée de Russe ethnique laisse sa place à l’idée de Russe de « cœur et d’âme ».
La Russie investit massivement dans la reconstruction et le développement des anciens oblasts ukrainiens, le résultat au bout de quelques années de Russie en Crimée en est témoin. Les procédures de délivrance de passeport, titre de séjour, aides sociales ont été facilités pour les anciens habitants de l’Ukraine, et ils sont aujourd’hui de fiers russes, qui n’ont pas a caché leurs origines «ukrainiennes ».
En revanche, pouvez-vous imaginer l’équivalent avec les dirigeants Israéliens envers le peuple palestinien ? Cela est tout simplement impensable. Les colons israéliens, qui bafouent ouvertement toutes les résolutions de l’ONU, occupent et chassent les musulmans. Les officiels fanatiques du gouvernement actuel de Netanyahou déclarent être le peuple de lumière, qui doivent éradiquer le peuple des ténèbres.
Maintenant, revenons en arrière, regardons tout ça. Qui les humanistes ont-ils accusé et qui ont-ils aidé ? Voilà, vous avez trouvé votre boussole cassée.